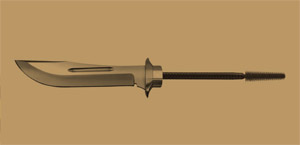 Province
ProvinceTexte Mathieu Gosselin
Mise en scène Benoît Vermeulen
Avec Amélie Bonenfant, Sophie Cadieux, Sébastien Dodge, Rose-Maïté Erkoreka, Mathieu Gosselin, Renaud Lacelle-Bourdon, Anne-Marie Levasseur, Lise Martin, Éric Paulhus et Simon Rousseau
Les habitants de la petite Province ont arrêté depuis longtemps de se parler, de se regarder dans
les yeux, de se prendre la main. Ils sont en fuite, mais immobiles, l’un à côté de l’autre. Les habitants
de la petite Province se sont dénaturés. Ils sont en guerre, mais ils ne le savent pas encore. Oui, une
guerre est sur le point de commencer. Les ombres, accompagnées de toute la nature, ont décidé de
reprendre coûte que coûte le territoire occupé par les humains. Ces humains dénaturés sauront-ils
exécuter les gestes leur permettant de survivre? Quelles traces laissera leur passage sur terre ?
Avec des thèmes comme la cyber-individualisation et la dégradation de la nature, Province est avant tout une célébration de l’humanité. Quand la vie tourne mal, ou quand la solitude devient trop lourde à porter, que reste-t-il? Des hommes et des femmes se regardant en toute simplicité, aimant se faire rire, se faire souffrir, aimant s’aimer. Finalement, il reste l’autre, l’ami.
Afin de souligner le 10e anniversaire du Théâtre de la Banquette arrière, retrouvez pour la première fois sur la scène de La Licorne, les dix comédiens de ce collectif qui ne cesse d’étonner et de surprendre. En effet, après Les Mutants, qui a soulevé l’enthousiasme du public et de la critique avec une nomination en 2011 pour le prix de l’Association québécoise des critiques de théâtre, la compagnie propose une toute nouvelle création de Mathieu Gosselin qui a déjà signé, pour la Banquette, le texte de La fête sauvage, finaliste pour le Masque du meilleur texte original et pour le Masque de la révélation.
Assistance à la mise en scène Olivier Gaudet-Savard
Décor et accessoires Marc Senécal
Costumes Linda Brunelle
Éclairages Erwann Bernard
Conception sonore Pierre-Marc Beaudoin
Tête-à-tête : Jeudi 3 mai
Une production La Banquette arrière
par Olivier Dumas

Crédit photo : Bruno Guérin
Juste avant la fermeture des lumières pour marquer le début de la première médiatique de Province, le sympathique placier parlait d’une rencontre hors du commun entre le Théâtre de la Banquette arrière et la Licorne. Sans parler d’un couronnement exceptionnel, on peut néanmoins affirmer que la nouvelle création écrite par le dramaturge Mathieu Gosselin, l’un des comédiens de la compagnie, constitue un morceau mémorable de la saison.
Dans une prémisse qui rappelle étrangement Venise-en-Québec d’Olivier Choinière, sans toutefois une charge satirique aussi flamboyante, la pièce qui réunit toute la cuvée 2001 du Conservatoire d’art dramatique de Montréal expose, dissèque dans toute sa cruauté et son horreur indicible une société atomisée, repoussée dans les derniers retranchements de son insignifiance. Le temps semble avoir suspendu son envol, alors que les personnages pataugent entre un factice confort matériel et une désinvolture quant au présent. Chacun des archétypes dépeints par l’auteur est un individu morcelé, sans l’ombre fragile d’un espoir ou d’une rédemption. Ils vivent dans un no man’s land, dans un cocon atrophié qui ressemble à une certaine forme du Québec contemporain (même si le récit évacue toute référence spatio-temporelle). Alors que Les Mutants, la précédente réalisation de la Banquette arrière, s’intéressait à nos racines, à notre passé et à l’héritage de la Révolution tranquille, Province s’ancre dans la réalité immédiate consumériste où toute dimension à l’avenir et à la mémoire collective demeure absente.
La facture visuelle du spectacle étonne par son éclatement, par ses multiples références, volontaires ou non. La scénographie se compose de cellules dispersées comme les pièces d’une maison entre plusieurs actions simultanées. Les nombreux cadres de bois présents sur le plateau rappellent la griffe de René Richard Cyr. Les immenses toiles en plastique transparent en arrière-scène donnent la sensation d’un lieu inachevé et indéfini, en perpétuelle déconstruction. Pendant les 95 minutes de la représentation, les spectateurs voient sous leurs yeux un microcosme d’un monde infernal par ses idéologies au totalitarisme doux et alarmant par ses préoccupations superflues. En arrière-plan, la nature gronde comme une meute d’hyènes réclamant son dû.
Les comédiens s’amusent dans des contre-emplois inattendus et souvent comiques. Avec sa vulnérabilité palpable, la colorée Sophie Cadieux est accoutrée comme Punky Brewster, fillette d’une série télévisée des années 1980. Le corps et le regard placide de Renaud Lacelle-Bourdon lui donnent les allures d’une poupée Bout d’chou grunge. Avec son allure militaire et son crâne rasé, Sébastien Dodge fait preuve d’une présence envoûtante. Le duo formé par Éric Paulhus (méconnaissable en douchebag, ses bijoux et sa perruque noire à la Elvis) et Rose-Maïté Erkoneka parodie à la perfection ces couples rutilants des téléréalités où l’apparence physique trône comme un seul maître. La pièce écorche au passage les quêtes mystico-spirituelles d’une femme esseulée à la recherche du prince charmant que rend de manière crédible Lise Martin.
Si dans ses grandes lignes la trame narrative de Province s’apparente à un collage disparate, le résultat est étonnement d’une grande cohérence, d’une indéniable fluidité. Et cet heureux résultat vient principalement de l’éclatante faconde de Mathieu Gosselin. Curieusement ou étrangement, sa plume possède à la fois une signature personnelle et des influences qui renvoient à d’autres univers. L’alliance entre des niveaux de langue populaires et poétiques crée des répliques d’une belle virtuosité, près d’un Gaston Miron. Le timbre de la voix de Claude Gauvreau peut résonner pour certains lors des passages sonores du gourou incarné par Mathieu Gosselin. Quelques instants avant la fin du spectacle, les dernières phrases exprimées par Sophie Cadieux rappellent certains extraits du discours de René Lévesque lors de la victoire électorale du 15 novembre 1976.
Malgré ces références, l’écriture du dramaturge révèle un souffle porteur de beauté. Elle témoigne d’une profonde désespérance agonique et l’effroi du vide abyssal qui pend sans cesse au bout du nez. Cette langue magnifie ces êtres, sans appartenance communautaire, sans idéaux autres que leurs jeux vidéos, leurs chirurgies esthétiques et leurs émissions aux parfums voyeuristes. Loin du misérabilisme ou du pathos, l’ironie toujours sous-jacente permet justement de révéler une dimension métaphorique à cette œuvre de violence, de chair et de sang. La mise en scène de Benoît Vermeulen donne ainsi une unité et une cohérence à cet univers postapocalyptique, en pleine hécatombe.
Par contre, la deuxième partie de la pièce manque par moment d’intensité. Redondante, elle s’étire un peu trop jusqu’à une conclusion plus faible. Avec autant de force et de fureur, le texte aurait bénéficié d’une finale plus fédératrice de toutes ses ramifications, de tous ses débordements fulgurants.
Compagnie qui sut charmer, éveiller ou provoquer les critiques et le public, le Théâtre de la Banquette arrière marque son dixième anniversaire d’un joyau noir très appréciable. Elle inscrit à nouveau ces préoccupations, aventures et recherches formelles avec éclat dans cette Province acidulée. Comme pour La fête sauvage, la plume de Mathieu Gosselin sait faire du bien là où ça fait mal.

