 Le Nô
Le Nô
 Le Nô
Le Nô
Le Nô est un des styles traditionnels de théâtre japonais, venant d'une conception religieuse et aristocratique de la vie. Ce sont des drames lyriques au jeu excessivement dépouillé et codifié. La gestuelle des acteurs est stylisée autant que la parole qui semble chantée.
Constitué fin XIIIe siècle au Japon, le Nô est une forme théâtrale unissant deux traditions : les Kagura, ou pantomime dansée, et les chroniques versifiées récitées par des moines errants. Le drame, dont le protagoniste est couvert d'un masque, était joué les jours de fête dans les sanctuaires. Ses acteurs, protégés par les daimyo et les shogun, se transmettent depuis lors de père en fils les secrets de leur art. Le Nô a évolué de diverses manières dans l'art populaire et aristocratique. Il formera aussi la base d'autres formes dramatiques comme le Kabuki. Après que Zeami a fixé les règles du Nô, le répertoire s'est figé vers la fin du XVIe siècle et nous demeure encore intact. Le Nô est unique dans son charme subtil (yûgen) et son utilisation de masques distinctifs.
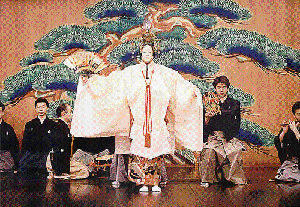
Ce sont des drames brefs qui dure entre 30 minutes et deux heures. Une journée de Nô est composée de cinq pièces, de catégories différentes. La salle est, en général, assez petite, quelques centaines de places, la plupart du temps sans fauteuils, les spectateurs étant assis sur leurs talons, sur ces nattes souples qui remplacent le plancher dans la maison japonaise. Tout le fond de la salle est occupé par la scène. Celle-ci, en souvenir d’un temps où elle était un édifice indépendant, dressé dans la cour d’un temple, est recouverte d’un toit de style bouddhique. Elle comporte deux parties : le plateau et le pont. Le plateau quadrilatère à peu près nu (excepté le kagami-ita, peinture d'un cèdre au fond de la scène), d’un peu plus de cinq mètres de côté, avance dans la salle, à droite ; sur le côté droit de ce plateau, un étroit balcon sur lequel s’installe le chœur, de quatre, huit ou douze chanteurs ; au fond, le plateau est prolongé par un espace large d’environ deux mètres où sont assis, face au public, les musiciens : de droite à gauche, une flûte, deux tambours à cordes et pour les pièces les plus animées, un « gros tambour » ; peinte sur la cloison du fond, l’image d’un pin antique qui étend ses branches noueuses parfois entrelacées de rameaux de pruniers en fleurs. Le plateau est prolongé, sur la gauche, par le Hashigakarile, une passerelle étroite qui peut avoir jusqu’à quinze mètres de long ; son extrémité est fermée par un rideau qui le sépare des coulisses. Ce principe a été adapté ensuite au Kabuki en Chemin des fleurs (Hanamichi).

Les musiciens entrent en scène les premiers, par le pont ; en même temps arrive le chœur, par une petite porte ménagée au fond à droite. La pièce commence par une ouverture instrumentale destinée à créer l’atmosphère : attaque de la flûte, bientôt accompagnée par les deux tambours. Les joueurs de tambours ponctuent cette musique de cris modulés assez surprenants pour qui les entend pour la première fois.
Puis vient le waki, « celui du coin », l’acteur secondaire, qui restera, à peu près tout le temps que dure la pièce, assis au pied du pilier de droite, sur le devant de la scène : son rôle est celui d’un spectateur, d’un voyant, ou mieux encore, d’un médium, car le shite, « l’acteur », le protagoniste, dont le masque produit un effet de « distanciation » est, le plus souvent, un fantôme, une divinité ou un démon apparaissant au waki. Presque toujours, nous sommes prévenus que le personnage central de la pièce n’est qu’une vision ou un songe de ce dernier. Le waki en effet, qui est généralement un moine, arrive, au cours d’un voyage, en un lieu illustré soit par un combat, soit par un antique roman d’amour, ou bien encore hanté par une divinité ou un démon. Un vieillard ou une jeune femme qu’il rencontre là lui rappelle l’histoire et la légende de ce lieu pour lui révéler enfin qu’il ou elle n’est autre que le spectre du héros ou de l’héroïne, le démon ou la divinité qui hante ces parages. Le shite disparaît alors pour revenir l’instant d’après, en brillant costume et sous ses traits véritables. Puis il évoquera, par une danse, sa vie passée ou les traits de sa nature.
Une représentation complète de nô comprend cinq pièces choisies respectivement dans chacune des cinq grandes catégories entre lesquelles se répartit le répertoire. La pièce « d’ouverture » est une « pièce votive » ou « nô de divinité » Elle prépare le spectateur à ce qui va suivre en le mettant dans un état de réceptivité convenable. La seconde pièce met en scène un guerrier : le spectre d’un guerrier tourmenté par le souvenir de ses fautes, apparaît à un moine devant qui il retrace son dernier combat avant de disparaître, généralement apaisé par les prières du saint personnage. La troisième est une « pièce de femme » : une héroïne des temps passés vient, doux et pitoyable fantôme, implorer le secours du moine afin qu’il l’aide à se détacher des passions qui l’enchaînent encore au souvenir de sa vie terrestre. Puis vient une pièce dite « du monde actuel ». Celle-là contient déjà l’embryon d’un drame et peut comporter une action assez animée, par exemple une scène tirée d’un récit épique ; ou bien c’est l’histoire d’une « folle » : la plupart du temps une mère dont l’esprit est troublé par la disparition de son enfant qu’elle finira par retrouver, à moins qu’elle ne découvre une tombe. Enfin, pour terminer sur un rythme plus rapide, endiablé, un « nô de démon » ; démon que notre moine va exorciser ou - pourquoi pas - convertir, puisque, « par nature, tout être porte en lui la faculté de devenir bouddha ».
Ce rapide survol de cinq pièces dont chacune dure une heure ne permet évidemment pas d’évoquer toute la densité, toute la gravité que recèle un tel spectacle, et encore moins la tension d’esprit qu’il produit chez le spectateur. Celui-ci ne pourrait supporter le spectacle si les cinq nô se suivaient sans interruption ; d’où la nécessité des intermèdes comiques, des kyôgen qui, déclenchant un rire mécanique, viscéral, assurent la détente nerveuse indispensable.
Il y a quatre catégories principales d'acteurs de Nô, et huit catégories principales de rôles:
* Le Shitekata correspond au type de jeu d'acteur le plus représenté.
Ces acteurs interprètent divers rôles, dont le Shite (le protagoniste),
le Tsure (compagnon du Shite), le Jiutai (Chœur chanté, composé
6 à 8 acteurs), et les Koken (serviteurs de scène).
* L'acteur Wakikata incarne les rôles de Waki, personnage secondaire qui
est la contre-partie du Shite.
* Le Kyogenkata est le style de jeu réservé aux acteurs jouant
les rôles populaires dans le répertoire Nô
et toute la distribution des pièces Kyogen (représentées
en intermède entre deux pièces Nô).
* Le style Hayashikata est pour les musiciens qui jouent des quatre instruments
utilisés dans le Nô.
Une pièce de Nô implique toutes les catégories d'acteur. Il y a approximativement 250 pièces au répertoire et six catégories de Nô, qui sont classées par sujet:
* 1re catégorie: pièces de dieux.
* 2e catégorie: pièces de guerriers.
* 3e catégorie: pièces de femmes.
* 4e catégorie: pièces de femmes folles.
* 5e catégorie: pièces de démons.
* Okina/Kamiuta: pièce unique alliant danse et rituel Shinto.
(La plus ancienne pièce du Nô)
Il y a environ 1500 acteurs professionnels de Nô au Japon aujourd'hui, et cette forme d'art recommence à prospérer. Contrairement au Kabuki qui est toujours resté très populaire, le Nô s'est peu à peu tourné principalement vers une certaine élite intellectuelle. Les cinq familles de Nô sont les écoles Kanze, Hosho, Komparu, Kita, et Kongo. Les familles de Kyogen étant à part.

Les origines
"Item, voici comment débuta le sarugaku au temps des dieux : au moment où la Grande-Divinité-qui-illumine-le-Ciel se confina dans la Céleste-Demeure-Rocheuse, le Monde-sous-le-Ciel fut plongé dans les ténèbres ; lors, les huit cent myriades de dieux s’assemblèrent sur le Céleste-Mont-Kagu, et dans l’intention de captiver le divin Cœur de la Grande-Divinité, ils lui offrirent un kagura et commencèrent un seinô. D’entre eux, Ama-no-uzume-no-mikoto s’avança : [tenant] des bandelettes votives fixées à un rameau de sakaki, élevant la voix, soulevant d’un piétinement rapide un roulement de tonnerre, quand elle fut en état de possession divine, elle chanta et dansa. Comme cette voix divine lui parvenait indistincte, la Grande-Divinité entr’ouvrit la Porte-Rocheuse. La terre, de nouveau, s’éclaira. Les divines faces des dieux resplendirent. Le divin divertissement de ce temps-là fut, dit-on, le premier des sarugaku.
Item, dans la patrie du Bouddha, quand le riche-homme Shudatsu eut édifié le monastère de Gion, au moment de la dédicace [de celui-ci], alors que le Shaka-nyorai était en train d’expliquer la Loi, Daiba, suivi d’une myriade d’hétérodoxes [tenant] des bandelettes votives fixées à des branches d’arbre et des feuilles de bambou, dansait et chantait à tue-tête, de telle sorte que la prédication devenait impossible ; lors le Bouddha lança un coup d’œil à Sharihotsu, et celui-ci, pénétré de la puissance du Bouddha, alla disposer dans la pièce du fond tambours et gongs et, mettant à contribution le génie d’Anan, la sagesse de Sharihotsu et l’éloquence de Furuna, il fit exécuter soixante-six mimes ; lors les hétérodoxes, oyant le son des flûtes et des tambours, se groupèrent au fond, et à ce spectacle, furent calmés. Profitant de ce répit, le Nyorai prononça sa prédication. C’est de là que date, dans l’Inde, le commencement de notre voie.
Item, au Japon, sous le règne de Kimmei-tennô, sur la rivière Hatsuse, dans la province de Yamato, à l’occasion d’une crue, une jarre venue de l’amont descendit le courant. Du côté du torii cryptomère de Miwa, un courtisan recueillit cette jarre. Dedans, il y avait un enfançon. Ses traits étaient charmants. Il était pareil à un joyau. Puisqu’il s’agissait d’un être descendu du ciel, on rendit compte au Palais. Cette nuit-là, dans un songe de l’Empereur l’enfançon déclara : « Moi que voici, je suis la réincarnation du Premier-Souverain du Grand Empire Shin. Ayant avec les Régions-du-Soleil des liens de karma, à présent, je m’y suis manifesté ». L’Empereur, estimant qu’il y avait là un prodige, le fit mander au Palais. A mesure qu’il croissait en âge, il dépassait quiconque en sagacité, de sorte qu’à quinze ans, il s’était élevé au rang de ministre, et l’Empereur lui conféra le nom de Shin. Or, le caractère shin se lit hata, et voilà pourquoi il se nomma Hata no Kôkatsu. Jôgu-taishi, à un moment où l’Empire connaissait quelques troubles, se référant aux précédents fastes de l’âge des dieux et de la patrie de Bouddha, commanda soixante-six mimes à ce Kôkatsu ; par la même occasion, il sculpta de sa propre main les masques pour les soixante-six mimes, et il voulut bien les confier à Kôkatsu. On présenta [ces mimes] au Pavillon-des-audiences du Palais de Tachibana... On appela [ces mimes] sarugaku... Kôkatsu transmit son art à ses descendants."
(De la transmission de la fleur de l’interprétation, Livre IV).
C’est en ces termes que Zeami, dans
ses traités secrets de l’art du sarugaku-no-nô, évoque
la triple origine, japonaise, bouddhique (c’est-à-dire indienne)
et chinoise, de son art qui devait devenir le nô, le
premier des trois genres classiques du théâtre japonais. Nous retrouvons
continuellement des traces de ces trois éléments, auxquels vient
s’ajouter, pour le théâtre moderne, l’influence occidentale.
En cinq siècles, le nô n’a guère évolué, mais son mouvement s’est ralenti. On a pu établir, en effet, que la même pièce, jouée aujourd’hui, dure presque deux fois plus longtemps qu’autrefois. C’est à cette particularité qu’est dû ce qui apparaît aujourd’hui au profane comme le caractère distinctif de ce théâtre, à savoir sa lenteur et sa dignité hiératique. Et c’est ainsi qu’il est devenu cet art de musée que de pieux conservateurs entretiennent avec componction devant un public restreint de fidèles confits en dévotion.
Il n’en reste pas moins que le nô est aujourd’hui encore un spectacle d’intérêt, et qu’il provoque chez le spectateur, du moins lorsqu’il est bien interprété, un état d’esprit voisin de celui que Zeami entendait susciter. Sa densité esthétique est telle qu’un programme de cinq nô serait insupportable sans les intermèdes comiques, les farces appelées kyôgen que, très tôt, on avait pris l’habitude d’intercaler entre deux nô successifs. Le ressort comique est souvent grossier. Il s’agit avant tout de provoquer une détente nerveuse par un rire franc et sans arrière-pensée. Les têtes de turc du kyôgen sont essentiellement les mêmes que celles de nos fabliaux : la femme, le seigneur, le curé (ici le desservant d’un temple bouddhique), le valet sot ou fripon.
Quelques rares kyôgen s’élèvent presque au niveau de la comédie de mœurs, et l’on pourrait les rapprocher des premières comédies de Molière encore très proches de la farce pure : Sganarelle ou Scapin sont des personnages de kyôgen. Les kyôgen contribueront, au XVIIe siècle, à la formation d’un théâtre d’action aux antipodes du nô, le kabuki.

Sources images
www.osamurai.hpg.ig.com.br/ no.htm.
japan-hotelguide.com/ guide/intro/
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/kg_plays/kg_plays03.html